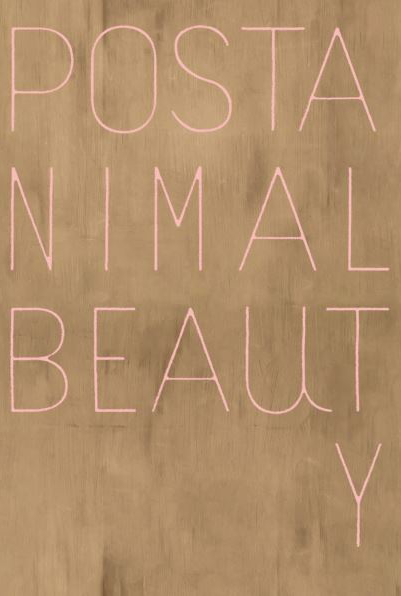Guide de visite
Alain Huck. Respirer une fois sur deux
Réalisée en étroite collaboration avec Alain Huck (*1957), l’exposition propose de traverser près de trente ans de création, depuis les premières œuvres sur toile jusqu’aux dessins les plus récents, en passant par les fusains monumentaux qui ont fait la notoriété de l’artiste. Elle s’articule autour de la question du texte et de son rapport à l’image, du langage et de sa représentation, de ce qui peut être dit ou de ce qui est tu, de ce qui fait mémoire ou de ce qui fait histoire. Au même titre que, dans les œuvres, des significations surgissent du montage entre texte et image, de la superposition d’images distinctes ou encore de l’incertitude de l’image elle-même, l’exposition est conçue par associations d’idées. Huck crée ici des dialogues entre des œuvres de périodes et de nature très différentes. Des travaux issus de séries de dessins majeurs côtoient des œuvres réalisées sur des supports aussi divers que des bâches, des sacs de jute, des plantes ou encore des néons, en un parcours non chronologique, générateur de sens.
À travers trois salles s’articulent trois thématiques qui traversent l’œuvre de Huck: la question de la Nature, de l’Histoire, du Contrat social. Mais, plus imperceptible, et contenu dans le titre de l’exposition, circulant dans et au travers des œuvres, il y a la question de la respiration: Respirer une fois sur deux. La respiration est ce souffle qui permet l’articulation du langage, la formulation de récits, la transmission de l’histoire, l’amorce d’une narration ; elle se ressent dans les supports des œuvres susceptibles de bouger au gré des dépla- cements d’air créés par les corps en mouvement ; elle est le souffle nécessaire à la déambulation dans l’espace de l’exposition.
Salle 1
Nature
La phrase Vite soyons heureux il le faut je le veux (2006) projetée sur de monumentales bâches en tissus de couleurs vives accueille les visiteur.euse.s. Cette même phrase donnait son titre à une série de 269 dessins qui constituent l’archive du travail effectué par Huck entre 1993 et 2007. Ouvrir l’exposition par cette phrase, c’est marquer l’importance du texte pour l’artiste, tout en soulignant le caractère instable de ses significations – il est projeté, et donc éphémère. Projeter cette phrase sur des tissus usés par le temps, c’est aussi marquer l’importance du support pour formuler une pensée, un travail. Le tissu renvoie à la toile du tableau, mais aussi à la bâche protectrice, à ce qui enveloppe la peau, qu’il s’agisse d’un habit ou d’un abri. Qui dit projection et tenture dit théâtre, cet espace dans lequel, comme dans celui de l’exposition, une narration peut s’amorcer.
En face de Vite soyons heureux il le faut je le veux se déploient les dessins de la série Postanimal Beauty (1992–2023). L’artiste y superpose un vocabulaire de formes et de mots aux références multiples, entre note intime, slogan, murmure hésitant et déclamation. Le titre de la série invite à penser les relations entre l’humain et le plus-qu’humain (Postanimal), qu’il s’agisse du monde végétal ou animal, ou des mondes à venir.
Des sculptures en matière organique – un radeau d’agaves, un lit de fougères – ponctuent l’espace. La scarification des agaves de Éden Éden Éden (2012) évoque le rapport violent des humains au vivant, loin de l’évocation paradisiaque qui résonne dans le titre de l’œuvre.
Dans Addition de l’homme aux bêtes (2014), on devine en creux dans un tas de fougères séchées – ces plantes qui précèdent l’humain – l’empreinte d’un animal, celle d’un chat. Elle fait écho à l’empreinte d’une tête humaine dans le coussin de fougères de Sleeping without Eagles (2014), dont le titre semble répondre à ce rêve de l’artiste: «se reposer loin de la violence du pouvoir.»
Lorsque les visiteur.euse.s passent sous les bâches de Vite soyons heureux il le faut je le veux, les attend Walking without Dersou (2007), un bâton moulé en plomb, objet paradoxal qui potentiellement accompagne la suite de la déambulation. Inspiré du bâton salvateur de Dersou Ouzala, protagoniste du film éponyme d’Akira Kurosawa (1975), à la fois bâton qui soutient la marche et bâton de sourcier, il représente pour Huck le possible d’un rapport juste à la nature. Mais si Walking without Dersou porte la mémoire d’une harmonie possible avec les éléments naturels, il ne nous en présente que l’envers empoisonné.
Salle 2
Histoire
Cette salle rassemble des œuvres qui ont recours à la fiction comme moyen pour dire l’Histoire, pour représenter la catastrophe – de la disparition d’un être, de la destruction des corps et du vivant. Dans Chrysanthemum (2013), une forme qui est à la fois fleur et évocation visuelle d’une explosion atomique surgit du noir du fusain. L’image est empruntée à l’ouvrage Dites-nous comment survivre à notre folie de Kenzaburō Ōe (1969), dans lequel la fleur opère également comme métaphore d’une tumeur qui envahit le protagoniste. Le texte de Ōe fait résonner la terreur incommensurable de la catastrophe collective avec le saisissement de l’individu.
À côté, quatre dessins monumentaux intitulés Année Zéro (2015) «regardent» la salle. Ce sont des visages-masques à la taille d’un corps humain. Surgis d’une bûche calcinée à laquelle l’artiste a ajouté deux trous pour signifier les yeux – ou l’absence de vision? –, ils se dressent comme des apparitions, seules formes anthropomorphes dans une salle travaillée par le corps et sa disparition, face à la sculpture Épitaphe (2008-2013) qui se propose de raconter le monde de façon «totalement fausse» ou «totalement vraie».
L’incertitude face à la véracité d’un récit, d’une narration, est représentée littéralement dans la série de dessins au graphite Darkness of Heart (2017–2018), dans lesquels une histoire est déroulée à rebours. Ici le sens des phrases se délite et à la place surgit l’image. Sur onze feuilles de papier, l’artiste a transcrit à l’envers l’intégralité du récit de Joseph Conrad, Heart of Darkness (1899), partant du dernier mot – «darkness» – et terminant avec le premier. Le grisé de l’écriture fait apparaître en épargne le fleuve Congo sur le blanc du papier. L’artiste remonte le cours du fleuve en remontant le cours de ce livre ambigu, récit de la violence coloniale et simultanément symptôme redoublé de cette violence, celle du regard occidental sur le continent africain comme surface de projection de ses propres états d’âme.
C’est avec Le Delta (2004-2005) que Huck avait exploré pour la première fois l’idée de faire apparaître un dessin en négatif à l’intérieur d’un texte, rencontre de deux travaux de la série Vite soyons heureux il le faut je le veux, l’un un texte de sa main, l’autre la vue aérienne d’un delta au lavis. Là, dans ce grand paysage où le blanc de l’épargne est aussi présent que le grisé des mots, s’accumulent des pensées quotidiennes emplies de doute, comme s’accumulent les sédiments charriés par le fleuve.
Salle 3
Contrat social
Dans la dernière salle on retrouve les préoccupations centrales du travail de l’artiste – le rapport à la nature, à l’histoire, au pouvoir, au collectif –, leurs paradoxes, mais aussi la multiplicité des formulations plastiques élaborées au fil des ans pour leur donner corps.
Comme le dit très simplement le titre de ce fusain, Certains dessins certains faits (2006), la question se pose de savoir ce dont il est possible de parler dans l’œuvre d’une vie, et de quoi, au juste, il a été question. Il est à la fois constat du travail accompli et aveux de tout ce qui ne pourra y être dit, ou représenté. Ce paysage de nuit, ce tourbillon de matière noire – le fusain –, que Huck a utilisé de façon virtuose sur plus de dix ans, est ici rendu à son état de poussière dont ne surgit aucune image, si ce n’est celle de notre reflet dans la vitre qui le protège. Le fusain qui ici engloutit l’image, ailleurs la révèle par transparence, comme un brouillard qui se lève – pour faire surgir un regard, aussi dérisoire soit-il, sur la désolation de l’Histoire, sur le destin des gens. Ainsi de M Marzabotto (2008), dessin monumental qui superpose des fragments de textes à un paysage indéfini et dont le titre renvoie aux ruines étrusques de Marzabotto, ce site traversé d’histoires violentes, témoin en 1944 du massacre de ses habitant.e.s par les troupes nazies.
Au centre de la salle, dos à dos, se trouvent des installations qui se superposent et se répondent. Ainsi, la vidéo Breath on Hemerocallis (2014) est projetée sur la série de dessins Vivre à vendre (2017-2020), comme un redoublement du théâtre d’ombres qui constitue la vidéo. Au revers, on trouve une sculpture réalisée en hommage au philosophe Jean-Jacques Rousseau, intitulée Du contrat social (2011–2013). Les mots tracés en lettres néon sont piégés, comme le dit l’artiste, «à l’intérieur d’un espace grillagé, très loin des idéalismes du XVIIIe siècle». Huck évoque ici le conflit entre nature et société cher à Rousseau: si la nature incarne l’ordre naturel des choses, force est de constater que trois cents ans plus tard, le Contrat social n’a pas été rempli.
L’exposition s’ouvrait sur la projection des mots Vite soyons heureux il le faut je le veux. Elle se clôt sur l’intimité des dessins de la série qui porte ce titre, mais agrandis, transposés, transformés par le graphite, ainsi que sur une vidéo intitulée Le langage (2005). Repris d’un dessin du même nom, listant plus d’une centaine d’espèces, Le langage évoque tous ces langages dont le sens nous échappe faute de savoir entrer en résonance avec les modulations infinies du monde plus qu’humain. Au contraire du constat désespéré contenu dans le titre du dessin Exit Lingua (2017) accroché juste à côté, et en contre-point à la respiration suspendue de Respirer une fois sur deux, le chuchotement du Le langage évoque sinon la promesse, du moins la tentative du souffle à maintenir, malgré tout, le lien au bruissement du vivant.