Bibliographie
Matthias Mühling et Stephanie Weber (éd.), Senga Nengudi : Topologies, cat. exp. Munich, Städtische Galerie im Lenbachhaus et Kunstbau, São Paulo, Museu de Arte, Münich, Ed. Hirmer, 2019.
Nora Burnett Abrams, Elissa Auther et alii, Senga Nengudi : Improvisational Gestures, cat. exp. Denver, Museum of Contemporary Art, 2015.

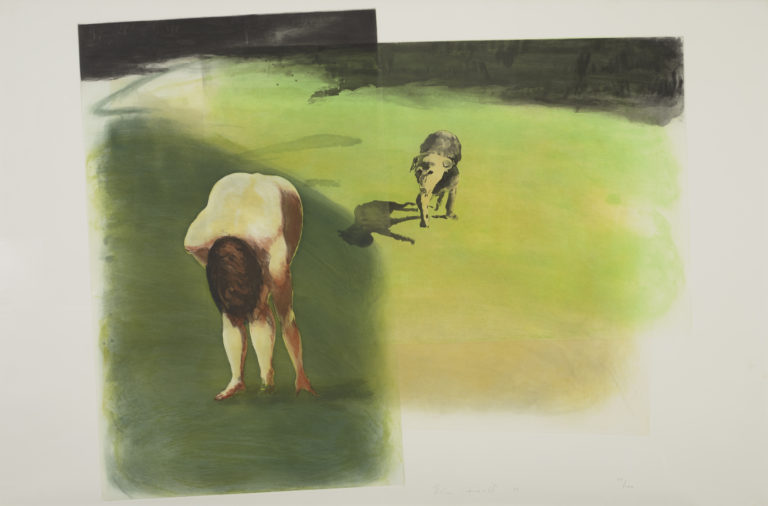


Née à Chicago et élevée en Californie, Nengudi fréquente l’université d’État de Californie à Los Angeles, où elle est la seule femme noire étudiante du département des beaux-arts dans les années 1960. Inspirée par le mouvement d’avant-garde japonais Gutai ainsi que le théâtre traditionnel Nô qu’elle découvre lors d’un séjour d’études à Tokyo, elle entreprend ses premières expérimentations avec le plastique et l’eau pour aboutir à la création des «Water Compositions» en 1970. Les compartiments en plastique thermoscellé remplis d’eau colorée qui forment Water Composition III sont suspendus à une épaisse corde attachée à un mur. Structurée mais souple, la sculpture conserve une forme fluide qui peut facilement changer selon son mode de présentation. L’impression de légèreté évoquée par l’eau contraste avec le sentiment de pesanteur des sacs en vinyle transparents qui tirent vers le bas la corde qui les soutient.
À la fois abstraites et viscérales, géométriques et organiques, les «Water Compositions» mettent en évidence le lien entre le corps vivant et la forme sculpturale, un lien initialement renforcé par le fait que les spectateur.ice.s étaient invité.e.s à activer la sculpture en entrant en contact avec elle. Présentées pour la première fois en 1971 dans le cadre d’une exposition collective d’artistes africain.e.s-américain.e.s organisée au Musée Rath de Genève, elles suscitent l’incompréhension du public et de la critique. À l’époque, la grande majorité des artistes noir.e.s sont en effet engagé.e.s dans une pratique artistique explicitement articulée à des questions sociopolitiques. Avec le temps, cependant, la portée subtilement politique du travail de Nengudi, qui fait allusion au corps féminin, à la couleur et au mouvement physique, a trouvé sa place dans l’histoire de l’art.